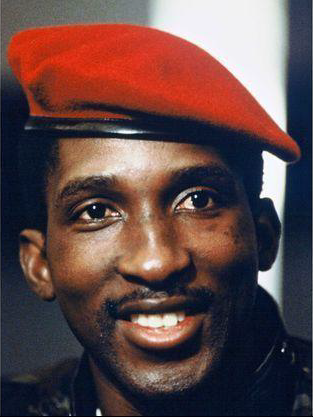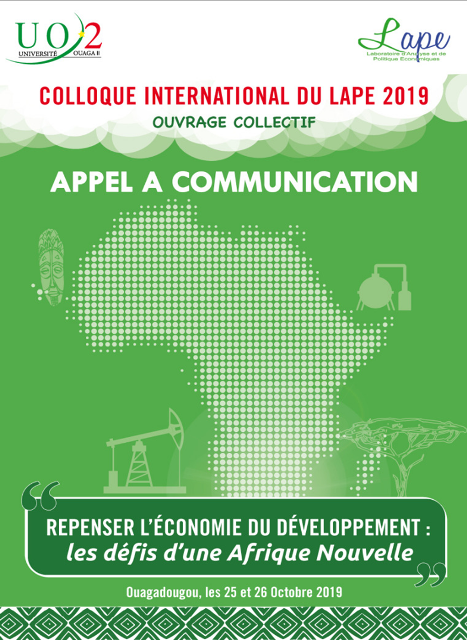MANIFESTATION
APPEL A COMMUNICATION AU COLLOQUE INTERNATIONAL Thomas SANKARA 2e Edition
L’Université Thomas SANKARA à travers le Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche Economiques et Sociales (CEDRES), lance un appel à communications pour la 2ème édition du colloque international Thomas SANKARA sur le thème : « Politiques de développement endogène : une réponse aux crises en Afrique ?».
APPEL A COMMUNICATION AU COLLOQUE INTERNATIONAL DU LAPE 2019: CANEVAS DE SOUMISSION DU RÉSUME DES ARTICLES
Télécharger l'appel à communication en Français
Download the call for papers in English
Télécharger le Canevas de Soumission du Résumé des Articles
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’Afrique est un continent de paradoxes. Bien qu’elle soit le continent le mieux doté en ressources naturelles, elle reste curieusement le continent qui abrite les populations les plus pauvres et les plus vulnérables au monde. Depuis les indépendances, les modèles de développement socioéconomique présentés comme remèdes aux problèmes du sous-développement et de la pauvreté généralisée ont très souvent été conçus de l’extérieur, importés et proposés, voire imposés à l’Afrique. Ces modèles, dans certains cas, ont même contribué à l’aggravation des problèmes qu’ils étaient censés résoudre. En effet, l’Afrique est confinée dans une posture de receveuse, de consommatrice au lieu d’être dans celle de conductrice dans le processus de mondialisation. Elle est de ce fait, restée en marge du processus du développement.
A regarder les performances de l’Afrique de nos jours, l’on constate avec désolation qu’elle demeure toujours un continent en proie à de nombreux problèmes de développement de manière répétitive, qu’elle reste dépendante et peine à satisfaire de façon adéquate les besoins les plus élémentaires des populations. Pourtant, l’Afrique dispose de nombreux atouts pour répondre aux attentes de ses populations et s’insérer avec certitude et beaucoup plus de force dans l’économie mondiale. Elle bénéficie d’une population majoritairement jeune, de ressources naturelles abondantes à celles constatées dans la majeure partie du reste du monde.
En dépit de tous ces atouts, pourquoi alors, l’Afrique est à ce stade ? Qu’est-ce qui explique les niveaux de développement contrastés sur ce continent ? Les insuffisances résident-elles dans les formulations des stratégies de développement, ou relèvent-elles de l’ordre institutionnel ou finalement s’agit-il des gouvernants africains qui sont en cause ? Les fondements théoriques contemporains de développement sont-ils désuets ou éprouvent-ils des insuffisances à s’adapter aux contextes africains ? Auquel cas, quels modèles de développement pour une Afrique nouvelle ? Sur quoi devraient reposer les fondements de ces « modèles africains » pour son développement ? La pertinence de l’ensemble de ces questionnements globaux justifie la nécessité d’une réflexion approfondie non seulement sur le développement en Afrique, mais aussi sur l’universalité des principes de l’économie du développement.
Il est de plus en plus admis dans le monde académique et partagé par certains acteurs économiques que le processus de transformation des économies africaines appelle une refondation profonde des modes de pensées, une appropriation, en toute indépendance et sans influence aucune, du concept de développement. Si c’est l’homme qui est mis au centre du développement, il conviendra alors de mettre au cœur de l’analyse, les essences premières de l’homme c’est à dire, son environnement, sa société, ses institutions, sa culture, et ses us et coutumes. Dépouiller l’analyse de ces dimensions, c’est la dépouiller de sa quintessence, c’est la rendre zombi et donc, la mettre au service des autres.
L’une des missions de la recherche étant d’éclairer les citoyens et les pouvoirs publics sur les mutations sociétales, il est aujourd’hui fondamental de questionner à nouveau la profession des économistes, notamment, les choix de méthodes et de postures scientifiques qu’ils adoptent pour appréhender la réalité socioéconomique du continent. C’est le lieu de mener la réflexion sur les fondements des théories du développement dans le contexte africain dans un effort collectif visant à positionner l’Afrique, de manière irréversible sur le chemin du succès de son développement.
C’est dans cette dynamique que se situe la vision du Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche Economiques et Sociales (CEDRES), à travers le Laboratoire d’Analyse et de Politique Economiques (LAPE) de l'Université Ouaga II et du Centre de Formation, d’Orientation et de Recherche pour la Gouvernance Economique en Afrique (FORGE-Afrique). A cet effet, ils organisent en partenariat avec le Réseau Think Tank Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (RTT-UEMOA) un colloque international sur les défis d’une Afrique Nouvelle.
La particularité de cette édition du colloque réside dans la priorité accordée aux problématiques de développement en Afrique. Il offre donc, l’opportunité aux différentes catégories d’acteurs de se réunir, d’asseoir un dialogue ouvert et prospectif, de partager leurs connaissances, de s’enrichir de leurs mutuelles expériences et d’apporter leur contribution à la compréhension des grandes préoccupations socioéconomiques et politiques contemporaines de l’Afrique. Ainsi, il s’agit, en dernier ressort, d’aider à identifier des « thérapies endogènes » et efficaces aux questions de développement qui se posent à l’Afrique autour des axes de recherche mentionnés ci-dessous sans prétendre à leur exhaustivité :
AXES DE RECHERCHE
Axe 1 : Méthodologie, épistémologie et didactique économiques
- Relations de l’Afrique traditionnelle avec l’économique
- Ancrage des méthodes scientifiques et d’enseignement dans le contexte africain
- Les économistes africains et les discours sur le développement de l’Afrique : à qui la faute ?
- Stratégies, modes de pensées et d’appréhension du développement en Afrique
- Osez penser futur et réinventer l’avenir de l’Afrique
- Tradition, gouvernance et pouvoir politique en Afrique
- L’homo economicus n’est-il pas multiple ?
Axe 2 : Institution, gouvernance et transformation structurelle
- Mutation institutionnelle, climat des affaires et promotion des initiatives privées
- Ingénierie institutionnelle et processus politiques
- Démocratie, corruption et réformes économiques
- Démocratie et autocratie : quel régime politique pour le développement de l’Afrique ?
- Dynamique institutionnelle des territoires et développement
- Acteurs politiques, société civile, autorités religieuses et coutumières, processus électoraux et alternance des régimes politiques
- Révolution numérique et les défis de la transformation structurelle
- Transfert des technologies et transformations structurelles
- Politiques industrielles, énergétiques, infrastructurelles et transformation structurelle
- Capital humain, dividende démographique et compétitivité
Axe 3 : Perception de l’intégration dans les sociétés africaines : décideurs politiques, institutions et peuples
- Adéquation entre politiques nationales et politiques communautaires
- Diaspora africaine et place de l’Afrique dans le monde
- Ouverture et insertion de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales
- Stratégie géopolitique, nouvelles dynamiques de coopération sécuritaire, diplomatique et développement
- Migrations, mobilités des personnes et intégration régionale en Afrique
- Tourisme et intégration en Afrique
- Zone de libre-échange continentale africaine, intégration monétaire africaine et l’hétérogénéité des pays
Axe 4 : Histoire, culture, mutations sociales, tourisme durable
- Economie informelle, protection sociale, genre, inégalités et pauvreté
- Culture, migration et dynamiques interterritoriales
- Culture de solidarité communautaire et développement local en Afrique
- Conflits, insécurité, réconciliation et paix
- Migrations, insertion sociale, paix et sécurité
- Tourisme et croissance inclusive
- Tourisme, paix et développement en Afrique
Axe 5 : Environnement, changement climatique et sécurité alimentaire.
- Energie et développement durable
- Economie verte et industrialisation
- Coûts économiques des changements climatiques
- Agriculture biologique et sécurité alimentaire
- Ressources naturelles et développement durable
Axe 6 : Financement du développement en Afrique
- Marchés financiers, innovation financière, finance inclusive et entrepreneuriat durable
- Commande publique : nouvel enjeu de développement de l’Afrique et durabilité des infrastructures publiques
- Mobilisation des ressources, choix des instruments fiscaux et efficacité de la politique budgétaire
- Finance islamique : l’émergence de nouveaux partenaires financiers pour l’Afrique
- Ressources extérieures et financement du développement endogène
- Investissements, IDE, transferts de fonds des migrants, et transformation structurelle de l’Afrique
Le comité scientifique privilégiera les propositions portant sur des perspectives pour une nouvelle économie du développement pour l’Afrique, mais aussi les contributions innovantes et celles portant sur les enjeux d’actualité. À l’issue du colloque les meilleurs articles retenus seront soumis à un comité de lecture anonyme en vue de la publication d’un ouvrage collectif si les auteurs le désirent.
PREPARATION DE VOTRE RESUME
Votre résumé doit utiliser le style Normal et doit tenir dans la zone prédéfinie. Votre résumé ne doit pas dépasser 300 mots. La zone s’agrandit sur 2 pages au fur et à mesure que vous y ajoutez du texte / des diagrammes.
- Le titre doit être aussi bref que possible mais suffisamment long pour indiquer clairement la nature de l’étude. Mettez en majuscule la première lettre du premier mot uniquement (noms et lieu exclus). Pas de point à la fin.
- Les résumés doivent indiquer brièvement et clairement l’objectif, la méthodologie utilisée, les principaux résultats et les implications de politiques
- Objectif: Enoncez clairement l’objectif de l’article
- Méthode: Décrivez clairement votre approche méthodologique.
- Résultats: Présentez vos résultats dans une séquence logique et soulignez les aspects nouveaux et importants de l’étude.
- Format Word, police Times New Roman, taille 12 et interligne simple
- Mode d’envoi
Envoyer simultanément aux adresses suivantes : colloquelape2019@gmail.com / colloquelape@univ-ouaga2.bf
Objet du mail : Résumé-Candidature-Colloque LAPE 2019
Télécharger l'appel à communication
Télécharger l'appel à communication en Anglais
Télécharger le Canevas de soumission du résumé des articles pour le colloque international du LAPE 2019
MODALITES PRATIQUES D’ENVOI DES CONTRIBUTIONS
Les communicateurs ont la possibilité d’inscrire leurs travaux dans l’un des axes déclinés ci-dessus pour développer un des sous thèmes en français ou en anglais. Ils sont invités à soumettre un résumé comptant au plus 300 mots conformément au canevas de soumission du résumé des articles téléchargeable sur le site de FORGE-Afrique : www.forgeafrique.com ou à travers le lien https://www.forgeafrique.com/colloque-international-du-lape-2019-canevas-de-soumission-du-resume-des-articles , sur le site de l’Université Ouaga II : www.univ-ouaga2.bf et sur le site du CEDRES: www.cedres.bf. Ce canevas peut également être obtenu en s’adressant au secrétariat technique du colloque au : colloquelape2019@gmail.com / colloquelape@univ-ouaga2.bf.
CALENDRIER (dates importantes)
- 15 Février 2019 : Lancement de l’appel à communication.
- 15 Juillet 2019 : Date limite de soumission des projets de contribution.
- 25 Juillet 2019 : Avis du comité scientifique et notification aux auteurs.
- 25 Septembre 2019: Soumissions des versions complètes des papiers en version numérique (entre 25 000 et 30 000 signes espaces compris) et des présentations (Version PowerPoint pour 15 minutes maximum).
- 23-24 octobre 2019: Arrivée des intervenants étrangers.
- Vendredi 25 au samedi 26 octobre 2019 : tenue du colloque à Ouagadougou (Burkina Faso).
- Retour des invités: dès la fin du colloque suivant le plan de vol.
- 25 Janvier 2020 : Réception des articles sélectionnés pour publication dans un ouvrage collectif.
- 25 Avril 2020 : Publication de l’ouvrage collectif qui recense les meilleures communications.
COORDINATION
- Président:
- Pr Idrissa M. OUEDRAOGO, Directeur du Laboratoire d’Analyse et de Politique Economiques (LAPE), Directeur du CEDRES, Université Ouaga II
- Vice-Présidents :
- Pr Mahamadou DIARRA, Directeur du Laboratoire d’Economie Régionale et Internationale, Université Norbert ZONGO
- Pr Windkouni Haoua Eugénie MAIGA, Directrice de l’UFR-SEG, Université Norbert ZONGO
- Pr Omer Souglimpo COMBARY, Directeur Adjoint de l’Ecole Doctorale de l’Université Ouaga II
- Pr Noël THIOMBIANO, Chef du Département de l’UFR/SEG, Université Ouaga II
- Dr Sayouba OUEDRAOGO, Responsable de la recherche du CEDRES, Université Ouaga II
- Dr Idrissa K. OUIMINGA, Directeur de la recherche de l’Université Ouaga II
- Dr Ousmane TRAORÉ, Directeur Adjoint de l’UFR-SEG, Université Ouaga II
- Secrétariat technique :
- Dr Oumarou ZALLÉ, Université Norbert ZONGO ; Tel : (+226) 78 37 40 01
- Drs Pousseni BAKOUAN, Université Norbert ZONGO ; Tel:(+226) 70 39 60 64
- Drs Aminata OUEDRAOGO, Université Ouaga II ; Tel : (+226) 76 84 46 65
- Mr Erick TELIMSEIN, Tel : (+226) 71 71 42 59
E-mail : colloquelape2019@gmail.com / colloquelape@univ-ouaga2.bf)
- Membres :
Dr Jean Marie KEBRE, DGCOOP; Dr Romuald R. KINDA, Université Ouaga II; Dr Jean Erdjouman SANOU, BCEAO; Dr Fousséni RAMDE, Université Nazi BONI; Dr Bagassé Hervé KAFIMBOU, ARCOP; Dr Boukary SAWADOGO, Centre de Gestion Agrée; Dr Ra-Sablga Seydou OUEDRAOGO, Université Ouaga II; Dr Souleymane SANOGO, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako; Dr Jean Abel TRAORE, Université Norbert ZONGO; Dr Adama TRAORE, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako; Dr Tiatité NOUFE, Université de Ouahigouya; Dr Relwendé SAWADOGO, IBAM, Université Pr Joseph KI-ZERBO, Dr Soumaila GANSONRE, LAPE; Dr François-Xavier MUREHA, Université du LAC Tanganyika; Dr Ibrahima DIALLO, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako; Dr Ousmane Y. MAIGA, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako; Dr Fadogoni DIALLO, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako ; Dr Patrice Rélouendé ZIDOUEMBA, Université Nazi BONI ; Dr Kader SOMA, Université Nazi BONI ; Dr Issaka DIALGA, IFOAD, Université Ouaga II ; Dr Albert MILLOGO, Université Norbert ZONGO; Dr Serge KI, Université de Ouahigouya; Dr TINTA A. Almame, Université Joseph KI-ZERBO/Kaya ; Mariam BAKOUAN, Université Norbert ZONGO; Idrissa KABORE, Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso ; Abdoulaye SIRY, Université Ouaga II ; Prosper N. KOLA, GIZ ; Inoussa TRAORE, IBAM, Université Pr Joseph KI-ZERBO; Issa SARAMBE, Université Norbert ZONGO; Idrissa OUEDRAOGO, Université Panafricaine-Commission de l'Union africaine, Cameroun ; Yaya SOULAMA, Université Nazi BONI; Marcel THIOMBIANO, Université Nazi BONI.
MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE
- Idrissa M. OUEDRAOGO, Professeur Titulaire, Université Ouaga II, Burkina Faso
- Albert ONDO OSSA, Professeur Titulaire, Université Omar Bongo, Gabon
- N’gbo Gilbert Marie AKE, Professeur Titulaire, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire
- Adama Diaw, Professeur Titulaire, Université Gaston Berger, Sénégal
- Amadou SALL, Professeur Titulaire, University of Tennessee, USA
- Edward Oki TAFAH EDOKAT, Professeur Titulaire, Université Bamenda, Cameroun
- Mama OUATTARA, Professeur Titulaire, Université Félix Houphouët Boigny, Cote d’Ivoire
- Pam ZAHONOGO, Professeur Titulaire, Université Ouaga II, Burkina Faso
- Chérif Sidy KANE, Maître de Conférences agrégé, Université Cheick Anta Diop, Sénégal
- Boubié T. BASSOLET, Maître de Conférences, Université Ouaga II, Burkina Faso
- Gnaderman SIRPE, Maître de Conférences, Université Ouaga II, Burkina Faso
- Florent SONG-NABA, Maître de Conférences, Vice-président chargé de la Recherche et de la Coopération Internationale (VP/RCI), Université Ouaga II, Burkina Faso
- Jean-Marie KATUBADI-BAKENGE, Maître de Conférences, Université du Lac Tanganyika, Bujumbura, Burundi
- Jacques Gueda OUEDRAOGO, Enseignant-chercheur, Université Ouaga II, Burkina Faso.
- Fatou CISSE, Enseignant-chercheur, CRES, RTT-UEMOA
NB:
- Les papiers doivent être envoyés simultanément aux adresses suivantes :
- Dans le cadre de l’ouvrage, la bibliographie, les tableaux et les graphiques seront présentés comme suit :
- pour un livre : Nom, prénom, Titre de l’ouvrage (en italiques), ville, éditeur, année de parution ;
- pour un article ou un chapitre paru dans un ouvrage collectif : Nom, prénom, «Titre de l’article ou du chapitre» (entre guillemets), dans prénom et nom du ou des directeurs de la publication (dir.), Titre de l’ouvrage (en italiques), ville, éditeur, année de parution ;
- pour un article de revue: Nom, prénom (date de parution) Titre de l’article (entre guillemets), Titre du périodique (en italiques ou en souligné), vol., numéro, année de parution, pages ;
- Pour les tableaux, éviter la barre d’espacement pour essayer d’aligner les colonnes; choisir plutôt la fonction tableaux du logiciel de traitement de texte ;
- Évitez les conceptions graphiques exigeant la couleur pour la compréhension du schéma ou du tableau ;
- Écrire les nombres en lettres jusqu’à dix, en chiffres au-delà (sauf dans les documents techniques où il y a profusion de chiffres). À partir de 1 000, laisser une espace entre les centaines et les milliers. Les décimales sont séparées du nombre entier par une virgule (1,51 %).
APPEL A COMMUNICATIONS: 3ème ÉDITION DU FORUM DE LA RECHERCHE STRATÉGIQUE OUAGADOUGOU, 26-27 JUIN 2025
Le Centre national d’études stratégiques (CNES) organise la troisième édition de son Forum de la recherche stratégique sur le thème : L’Afrique et ses ressources stratégiques : enjeux, opportunités et défis de développement. Le forum est prévu pour se tenir du 26 au 27 JUIN 2025.
DEUXIÈME ÉDITION DU GRAND PRIX DE LA RECHERCHE STRATÉGIQUE
Le Centre national d’études stratégiques (CNES) du Burkina Faso lance un appel à candidatures pour la 2e édition du Grand Prix de la Recherche Stratégique (GPRS). Ce prix est destiné à récompenser les productions scientifiques qui contribuent significativement à la réflexion stratégique.

Créé en 2020, le Centre National d’Études Stratégiques (CNES) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique. En tant qu’outil d’aide à la décision au service de l’État, le CNES a pour mission d’analyser les questions stratégiques et de sécurité internationale, de contribuer à la formation de haut niveau stratégique et de participer au rayonnement de l’image internationale du Burkina Faso. Dans l’objectif de fédérer le leadership des études et recherches stratégiques, le GPRS comporte deux catégories :
▪ Un Prix senior : qui récompense un.e chercheur.e confirmé.e (Doctorat ou équivalence) et vise à mettre en lumière une carrière qui allie excellence et dynamisme.
▪Un Prix junior : qui met en valeur et encourage le brillant parcours universitaire d’un.e chercheur.e débutant.e (Mémoire de fin de cycle de Master ou équivalence).
THÉMATIQUES DE RECHERCHE
Sont éligibles au GPRS les travaux portant sur des thématiques d’intérêt pour le CNES. À titre indicatif, le CNES a pour centre d’intérêt, les axes thématiques suivants :
▪Extrémisme violent, lutte contre le terrorisme, criminalité transnationale organisée et autres défis sécuritaires ;
▪ Enjeux de défense et de sécurité ;
▪ Enjeux stratégiques en lien avec la géopolitique, la diplomatie et les relations internationales ;
▪ Enjeux géopolitiques et diplomatiques en lien avec la sécurité nationale ;
▪ Intelligence stratégique du Burkina Faso ;
▪ Gouvernance démocratique en lien avec la sécurité humaine ;
▪ Gouvernance économique et développement humain durable ;
▪ Sécurité nationale et enjeux de société ;
▪ Etc.
CONDITIONS DE CANDIDATURES
Critères d’éligibilité
Sont éligibles aux grands prix de la recherche stratégique, les candidat.e.s satisfaisant aux conditions suivantes :
Conditions générales
Être de nationalité burkinabè ou avoir mené les recherches soumises au Prix dans une université ou un centre de recherche burkinabè ;
Avoir mené des recherches dans les thématiques de recherche énumérées au point 2 (voir plus haut).
▪ Conditions spécifiques au Prix senior
Être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme jugé équivalent ;
Avoir publié son article au plus tard le 9 mai 2025 ;
Être âgé de 35 ans au plus au 9 mai 2025 ou au moment de la publication de l’article.
▪ Conditions spécifiques au Prix junior
Avoir soutenu son mémoire de Master 2 ou publié son article au plus tard le 9 mai 2025 ;
Être âgé de 27 ans au plus à cette date ou au moment de la publication du travail soumis.
Composition du dossier
Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :
▪ Une copie légalisée de la carte nationale d’identité ;
▪ Une photocopie légalisée du diplôme ou attestation (Doctorat ou équivalent pour les candidats au Prix senior et Master pour les postulants au Prix junior) ;
▪ Un curriculum vitae ;
▪ Une lettre de recommandation ;
▪ Une copie du travail de recherche soumis au jury ou publié (mémoire ou article selon les cas. Pour les chercheurs séniors, le prix ne porte pas sur la thèse de doctorat) ;
▪ Un résumé de la recherche en 500 mots au plus indiquant les objectifs, la problématique, la méthodologie, les résultats et les apports de la recherche à la réflexion stratégique.
Dépôt du dossier
Les pièces du dossier doivent être envoyées au plus tard le 9 mai 2025 à 12 h (heure de Ouagadougou), en un seul fichier et en version PDF aux adresses Email suivantes : awards.cnes@gmail.com ; forumstrategique@cnes.gov.bf
MODALITÉS DE SÉLECTION
Les dossiers sont soumis à l’appréciation du jury mis en place dans le cadre de l’organisation du GPRS. La sélection se fera selon les étapes suivantes :
▪ Une phase de pré-sélection des dossiers ;
▪ Une phase de sélection finale des dossiers.
Le jury examinera les travaux selon une grille d’évaluation basée sur des critères de fond (problématique, originalité, méthodologie, etc.) et de forme (qualité de l’écriture, respect de la rédaction scientifique, etc.).
Le jury contactera en cas de besoin les candidats présélectionnés pour des compléments d’information ou de documents. Seuls les candidats retenus seront contactés.
NB ! Les décisions du jury sont sans appel.
Les prix seront décernés lors de la 3ème édition du Forum de la Recherche Stratégique prévu les 26 et 27 juin 2025.
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Président : Pr Augustin LOADA, Université Saint-Thomas d’Aquin (USTA)
Membres
▪ Pre Valérie Ouédraogo ROUAMBA, Université Joseph Ki-Zerbo
▪ Pr Léon SAMPANA, Université Nazi Boni
▪ Pr Idrissa Mohamed OUEDRAOGO, Centre FORGE Afrique.
▪ Pr Abdoul Karim SAIDOU, Université Thomas Sankara
▪ Dre Sampala BALIMA, Centre national d’études stratégiques/Université Thomas Sankara
▪ Dr Kassem Salam SOURWEMA, Centre national d’études stratégiques/Université Thomas Sankara
▪ Dr Erdjouman SANOU, Centre d’analyse des politiques économiques et sociales
▪ Dre Samiratou DIPAMA, Université Thomas Sankara
▪ Dr Thomas OUEDRAOGO, Université Thomas Sankara
▪ Dr, Désiré DRABO, Centre national d’études stratégiques/Université Thomas Sankara
▪ Dr Guy Evariste André ZOUNGRANA, Centre national d’études stratégiques
CONTACTS
Pour toutes informations complémentaires relatives au GPRS, veuillez contacter le CNES aux adresses suivantes :
▪ Tel : (+226) 25 45 50 50
▪ Emails : awardscnes@gmail.com ;
forumstrategique@cnes.gov.bf
QUATRE (4) NOUVEAUX DOCTEURS SOUTIENNENT LEURS THESES DE DOCTORAT SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR IDRISSA M. OUEDRAOGO
Ils sont quatre docteurs a avoir réussi à défendre leurs thèses de doctorat, sous la direction du Professeur Idrissa M. OUEDRAOGO et la co-direction du Professeur Mahamadou DIARRA, Enseignant chercheur à l’Université Norbert Zongo, devant un jury international, du 9 au 13 janvier 2023 à l’Université Thomas Sankara. Il s’agit, désormais, des docteurs Li WANGA, Moumini BAMOGO, Yacouba TRAORE et de Domètière Christian Gaël SOMDA.
Ces impétrants ont abordé, respectivement, la problématique :
- Du « Rôle de l'innovation financière sur le lien système financier et croissance économique en Afrique Subsaharienne » ;
- De l’ « Essais sur les déficits de la balance des transactions courantes des pays de l’Afrique subsaharienne » ;
- De l’ « Analyse des effets de la concentration bancaire sur le lien entre système financier et croissance économique dans les pays de l'UEMOA » ;
- De l’ « Essais sur la stabilité macroéconomique : déterminants et effets sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans l’espace CEDEAO ».
A l’unanimité les différents jurys ont souligné la pertinence et l’actualité des thèses développées, malgré des imperfections à corriger.
Li WANGA étudie les effets de l’innovation financière sur la croissance économique, l’efficacité allocative des banques et sur la stabilité de la demande de monnaie en Afrique subsaharienne. Au plan méthodologique, il utilise successivement la méthode d’estimation Pooled Mean Group (PMG) pour évaluer l’influence de l’innovation financière sur la croissance économique, le modèle Tobit pour analyser l’influence de l’innovation financière sur l’efficacité allocative et la modélisation Vecteur Autorégressif Structurel (SVAR) en panel pour mettre en exergue l’influence de l’innovation financière sur la stabilité de la demande de monnaie. Il ressort de ses analyses trois principaux résultats.
- D’abord, lorsque l’innovation financière est mesurée par le ratio M2/M1, elle influence négativement la croissance économique et l’efficacité allocative des banques en Afrique subsaharienne.
- Ensuite, cette influence devient positivement si l’innovation financière est mesurée par le taux de croissance du crédit accordé par le système financier au secteur privé en pourcentage du PIB.
- Enfin, l’innovation financière ne déstabilise pas la demande de monnaie en Afrique Subsaharienne.
A la lumière de ses résultats, il préconise, d’une part, de faire la distinction entre ces deux types d’innovation financière et d’accompagner les types d’innovation financière qui améliorent les conditions d’octroi de crédit du système financier et d’autre part, de décourager les innovations financières qui accroissent la taille des actifs contenus dans M2-M1.
Quant au désormais Docteur Moumini BAMOGO, il analyse les enjeux des déficits courants de des pays d’Afrique subsaharienne sur la période 1980-2019. Pour ce faire, il s’interroge d’abord sur la soutenabilité des déficits en s’appuyant d’une part, sur la version augmentée de la méthodologie d’évaluation de la soutenabilité externe pour la détermination du seuil de soutenabilité du déficit courant, et d’autre part, sur les tests de cointégration en vue de comparer le solde courant soutenable et celui réellement observé.
Les résultats obtenus montrent que les déficits courants sont soutenables, mais cette soutenabilité demeure faible. De ce point de vue, sa thèse identifie ensuite par le biais d’un modèle intertemporel estimé à travers l’approche CS-ARDL, les déterminants du solde courant. Il ressort qu’à court terme, l’investissement et la dette extérieure affectent négativement le solde courant, tandis que le solde budgétaire, l’épargne et le revenu étranger ont un effet positif. À long terme, le solde budgétaire, le taux de change réel, la stabilité du gouvernement, l’épargne et le revenu étranger influencent positivement le solde courant, contrairement à l’investissement qui a un effet négatif.
Sa thèse analyse enfin la croissance économique dans un contexte d’équilibre courant par le biais de la loi multisectorielle de Thirlwall. Les résultats révèlent que le taux de croissance économique réel des pays d’ASS pris globalement est contraint par l’équilibre courant. L’ensemble des résultats trouvés sont souvent caractérisés par une hétérogénéité sous-régionale. Globalement, les résultats trouvés dans le cadre de sa thèse plaident pour l’instauration de règles limitant le seuil du déficit courant et celui du déficit budgétaire au sein des CER et au recours aux dettes concessionnelles pour accroitre la soutenabilité des déficits.
Au total, les thèses défendues ont été jugées recevables et ont été toutes appréciées par la MENTION TRES HONORABLE.
A. SIRY